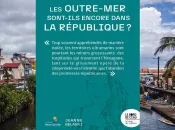Si dans les Outre-mer français -notamment en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française-, l’indépendance-association suscite des débats passionnés, parfois tranchés voire crispés, cette forme institutionnelle qui permet à un État indépendant de s’associer à un autre État pour lui déléguer certaines compétences, principalement régaliennes, est très présente dans le Pacifique, mêlant « pragmatisme » aglo-saxon et « consensus » océanien.
Un État associé est indépendant et souverain. Dans le cadre d’un accord de libre-association avec un État tiers, souvent plus peuplé, plus grand et développé, il délègue certains pouvoirs et compétences, notamment régaliennes : défense, affaires étrangères, monnaie ou encore nationalité. Le tout sous l’égide des Nations unies.
« L’indépendance-association est une forme institutionnelle reconnue par l’ONU dans le cadre des processus de décolonisation » écrit Léa Harvard, Maître de conférences en droit public à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, dans un article paru en juin dernier. C’est plus précisément la résolution 1541 de l’Assemblée générale des Nations unies qui consacre l’indépendance-association, comme l’un des cas permettant à un territoire non-autonome d’accéder à la pleine autonomie.
L’indépendance-association « est très large et vaguement mentionnée » dans cette résolution, et « la doctrine n’est pas uniforme », explique encore le juriste polynésien Hervé Raimana Lallemant. En d’autres termes, l’indépendance-association peut prendre plusieurs formes et le Pacifique fourmille d’exemples en la matière.
Tout du moins, cinq Nations insulaires de la région ont choisi de conclure un accord de libre association avec leur ancienne puissance administrante : les Îles Cook et Niue avec la Nouvelle-Zélande ; les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et la République des Palau (Palaos) avec les États-Unis.
Dans cet article dédié aux Îles Cook, nous expliquions déjà les liens entre cet État indépendant, non membre des Nations unies mais reconnu par celles-ci, et la Nouvelle-Zélande. Pour ce qui est de Niue, l’île entre les Cook et les Tonga a été annexée par la Nouvelle-Zélande en 1901, un an après le protectorat britannique. Niue obtient son indépendance-association en 1974. La Nouvelle-Zélande assure la protection de ces deux États, qui bénéficient de la citoyenneté néo-zélandaise et du dollar néo-zélandais. Des aides au développement leurs sont aussi octroyées par la Nouvelle-Zélande.
La Micronésie, les Marshall et les Palaos sont associées avec les États-Unis par le Traité de libre-association (Compact of Free Association), qui leur confie souveraineté et contrôle ultime sur leur territoire. Toutefois, le gouvernement fédéral américain assure leur défense, leur fournit des subventions et permet l'accès aux services sociaux américains à tous leurs citoyens.
En contrepartie, les États-Unis bénéficient de l'utilisation de ces îles comme bases militaires stratégiques, héritage de la seconde guerre mondiale et des essais nucléaires américains aux Îles Marshall, ainsi qu’un accès illimité aux terres et voies maritimes.
Sur la citoyenneté et la nationalité, ces États associés aux États-Unis ont fait le choix d’ériger les contours de leurs propres nationalités, tout en disposant d’avantages non-négligeables aux États-Unis. Ainsi, les ressortissants de ces trois États bénéficient d’un statut privilégié aux États-Unis, où ils peuvent entrer, étudier ou encore travailler sans nécessité de visa. Dans le sens contraire, les citoyens américains peuvent aussi entrer, étudier ou travailler dans ces États insulaires sans visa.
Outre ces cinq États associés, on recense dans le Pacifique d’autres formes de relations, plus ou moins autonomes. Les Îles Mariannes du Nord par exemple, qui faisaient partie avec la Micronésie, les Marshall et Palau des Territoires sous tutelle des Îles du Pacifique, sont devenus des territoires non-incorporés des États-Unis, au même titre que sa voisine Guam ou Porto Rico dans la Caraïbes. Kiribati, État indépendant, a confié sa défense à l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays gèrent également la défense de Nauru pour le premier, et des Samoa pour le second.
Les États associés face à la guerre d'influence entre les États-Unis et la Chine
L’exercice de l’État associé se frotte aujourd’hui à la silencieuse guerre d’influence que se livrent les États-Unis et la Chine. En signant un accord commercial avec cette dernière, les Îles Cook ont provoqué la colère du gouvernement néo-zélandais, coupant les aides au développement de l’État insulaire. Le gouvernement conservateur de Christopher Luxon n’a toutefois pas condamné son homologue des Îles Cook quand ce dernier a conclu un accord du même genre avec les États-Unis.
En 2023, lorsque les États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall et la République des Palau ont renouvelé leur accord de libre-association avec les États-Unis pour une durée de 20 ans, Washington a mis sur la table une aide globale de 7 milliards de dollars pour ces trois États. Non sans arrière-pensée, puisqu’il s’agissait pour l’administration Biden de contrer l’influence chinoise qui gagne du terrain dans le Pacifique sud.
Trois ans plus tard, la République des Palau s’est vu remettre par l'administration Trump un projet d’accord selon lequel l’État insulaire accepterai des migrants expulsés des États-Unis mais ne souhaitant pas rentrer dans leur pays d’origine. Le nombre de personnes, ni les contreparties ne sont précisées, ce qui a eu pour effet de refroidir les autorités de l’État insulaire.
La République de Palau doit avoir « toute latitude pour décider quels individus seraient acceptés », a estimé le chef de l’État Surangel Whipps Jr. Un refus qui, selon les autorités coutumières du pays, n’est « pas facile, parce que la demande vient de notre allié n°1. Nous sommes cependant certains que notre meilleur ami comprendra notre situation précaire et fragile de petit pays insulaire dans un monde complexe ».
Si l’exercice de l’indépendance-association peut donc se heurter aux enjeux géopolitiques et politiques internes des Nations, il n’en reste pas moins une voie de décolonisation originale, mêlant le « pragmatisme propre à la culture anglo-saxonne » à « la recherche du consensus » des cultures océaniennes. Les États-associés « sont des entités juridiques hors-normes par rapport au modèle occidental de l’État-nation », et ils « soulèvent des questions qui sont essentielles dans le contexte actuel, de mondialisation, d’interdépendance, qui fait qu’il est nécessaire de réfléchir à la façon dont on conçoit l’État et de penser l’État dans un contexte globalisé », dit encore Léa Havard.
Et la France ?
Selon l’article 88 de la Constitution du 4 octobre 1958, « la République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations ». Si la rédaction ne précise pas « libre-association », elle demeure conforme à la notion d’indépendance-association telle que reconnue par l’ONU. Toutefois, la France n’a encore jamais eu recours à cet article.
En réalité, il existe en France deux exemples qui se rapprochent de la notion d’indépendance-association : Andorre et Monaco. Depuis 1278, la France assure la défense d’Andorre, ce micro-État européen perché dans les Pyrénées, entre l’Hexagone au nord et l’Espagne au sud. La France assure aussi sa représentation au niveau des relations extérieures, et le chef de l’État est coprince de cette petite principauté (en l’occurrence Emmanuel Macron depuis 2017).
La principauté de Monaco est, quant à elle, sous protectorat français depuis 1861, renforcé en 1918 par un traité d'amitié protectrice et l’année suivante par le traité de Versailles. Depuis 2005, un nouveau traité signé avec la France a transformé cette protection en libre association et consacré l’indépendance administrative et diplomatique de la principauté. La France défend l'indépendance et la souveraineté de Monaco, tandis que le gouvernement monégasque exerce ses droits souverains en conformité avec les intérêts français.
Reste enfin le cas calédonien. En mai dernier, le ministre des Outre-mer Manuel Valls avait proposé un projet politique de « souveraineté partagée » permettant le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, puis leur délégation automatique à la France, avec l’instauration d’une double nationalité (française de droit et calédonienne), et l’établissement d’un statut international, le tout « ancré » dans la Constitution française à travers une Loi fondamentale.
Pour le ministre, cette proposition « permettait de garder un lien structurel, solide et pérenne entre la France et la Nouvelle-Calédonie et de régler le dossier du corps électoral, la question du droit à l’autodétermination et de sortir du processus de décolonisation ». « Face aux évolutions du monde et de la France », ce « compromis fructueux » aurait « offert garantie et protection à tous les Calédoniens », avait encore assuré Manuel Valls.
Mais ce projet a été rejeté par une partie des non-indépendantiste, le comparant à une indépendance-association. Ce qui n’est pas le cas puisqu’il n’était pas question que la Nouvelle-Calédonie accède à une indépendance requise pour conclure un accord de libre-association. À l'instar du projet signé à Bougival -dans lequel les compétences régaliennes ne sont plus transférées puis déléguées mais partagées-, le projet de Deva prévoyait que la Nouvelle-Calédonie reste inscrite dans la Constitution française, à travers une Loi fondamentale, sorte de petite constitution dans la grande, à l’image de l’Accord de Nouméa.
Lire aussi :