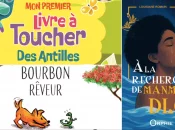Agriculture entravée, crise aiguë du logement, dépossession des peuples autochtones. Lors du débat parlementaire à l'Assemblée nationale initiée par le député guyanais Jean-Victor Castor (GDR) ce mercredi 26 novembre, Clarisse Da Silva (Experte des questions autochtones), Jean-Yves Tarcy,(Président de la Chambre d'agriculture de Guyane) et Malick Ho A Sim (Sécrétaire générale de l'ARMOS Guyane) ont dressé un constat alarmant de la question foncière sur leurs secteurs respectifs, dans ce territoire d'une superficie équivalente au Portugal. Une concentration excessive de la propriété foncière entre les mains de l'État qui entrave les différents enjeux d'aménagement du territoire et accentue les urgences sociales, environnementales et démographiques du territoire.
Avec ses 84 000 km², la Guyane est le plus vaste département français. Pourtant, entre 90 et 95 % de ses terres appartiennent à l’État. Une singularité foncière qui structure l’ensemble des blocages économiques et sociaux du territoire.
Premier secteur entravé par la question foncière : L'agriculture guyanaise, bien que ne couvrant que 0,3% du territoire, joue un rôle crucial. Selon le représentant de la Chambre d'Agriculture, elle garantit la sécurité alimentaire, apporte de la stabilité à la population et constitue un pilier essentiel pour l'aménagement du territoire au-delà des zones littorales. Pourtant, cette activité vitale se heurte à une triple problématique foncière qui paralyse son développement.
La première problématique concerne la sécurisation des exploitations existantes. De nombreux agriculteurs sont installés depuis des décennies sur des terrains sans titre définitif, ce qui les exclut du crédit bancaire et des aides à l'investissement, les maintenant sous la menace de la précarité juridique. Cette situation absurde condamne des exploitants établis de longue date à l'impossibilité de développer leur activité, faute de garanties foncières reconnues par les institutions bancaires et administratives.
Lire aussi : Guyane : L’EPFA Guyane accélère le transfert des activités agricoles à la SAFER Guyane
Le deuxième obstacle concerne l'accès aux nouvelles terres aménagées. Les procédures d'attribution des terres aménagées sont très lentes, avec des délais qui se comptent en années, et manquent de transparence sur les critères d'attribution, empêchant l'installation des jeunes et la diversification des productions.
Lire aussi : La SAFER Guyane operationelle, entre en action pour structurer le foncier agricole
Au-delà de l'accès au foncier, les agriculteurs guyanais doivent supporter des coûts d'infrastructures considérables. Le président de la Chambre d'Agriculture Jean-Yves Tarcy a insisté sur le fait que la productivité dépend du cadre de vie (pistes, eau, électricité, internet), des investissements très lourds sur le territoire pour l'agriculteur. Contrairement à l'agriculture hexagonale où les parcelles sont généralement déjà viabilisées, l'agriculteur guyanais doit créer l'ensemble des infrastructures de base avant même de pouvoir commencer à produire, ce qui représente un investissement initial prohibitif.
La spéculation foncière aggrave la situation
La rareté du foncier accessible a engendré une spéculation préoccupante. Le représentant de la SAFER a expliqué que les prix peuvent atteindre 6 000 euros l'hectare, et que la SAFER travaille à réguler le prix du foncier pour le diminuer, tendant vers 3 000 ou 2 000 euros l'hectare. Cette spéculation, sur un territoire où l'État possède l'essentiel des terres, révèle les dysfonctionnements d'un système où la puissance publique ne joue pas pleinement son rôle régulateur. Une injustice particulière frappe les agriculteurs pratiquant l'agriculture de subsistance. Le représentant de la Chambre d'Agriculture a révélé que sur 6 100 agriculteurs recensés en Guyane, 80% se situent dans l'ouest du territoire et pratiquent l'agriculture familiale sur abattis, mais ne peuvent bénéficier d'outils, de dispositifs et d'aides publiques car ils ne sont pas dans une démarche conventionnelle. Cette exclusion administrative a des conséquences dramatiques. Lors des inondations du Haut-Maroni il y a deux ans, les agriculteurs situés dans le flanc du fleuve n'ont pas pu bénéficier d'aide sur la calamité agricole, malgré leur recensement dans les statistiques officielles.
Lire aussi : L’EPFA Guyane et la SAFER Guyane s’allient pour la gestion durable des terres agricoles
La crise du logement : une urgence sociale ignorée
La situation du logement en Guyane illustre l'ampleur de la crise foncière. Comme l'a rappelé Malik Ho A Sim, le représentant d'ARMOS Guyane, la fédération des bailleurs sociaux, depuis 1950, la population guyanaise a augmenté dix fois plus vite que celle de l'Hexagone, avec aujourd'hui 40% de la population âgée de moins de 20 ans. Cette croissance démographique exceptionnelle s'accompagne d'une pauvreté massive : 53% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 16 000 familles attendent un logement abordable, et 80% des ménages sont éligibles aux logements très sociaux.
Des besoins colossaux face à une production dérisoire
Face à ces enjeux, les besoins sont considérables : 45 000 logements à construire dans les 10 prochaines années, sans compter les écoles, voiries et infrastructures de base. Or, la production actuelle est dramatiquement insuffisante. Le territoire ne produit que 1 500 logements par an, soit un tiers du besoin réel, tandis que le marché privé demeure largement inaccessible pour la majorité de la population.
Cette incapacité à répondre aux besoins se traduit par une progression alarmante de l'habitat informel. On recense aujourd'hui plus de 40 000 constructions spontanées et informelles, soit presque deux fois plus que le nombre de logements abordables. Plus inquiétant encore, cet habitat informel croît beaucoup plus vite que la capacité à construire du logement neuf et abordable, créant une spirale de précarité et d'insalubrité.
Lire aussi : L’EPFA Guyane et la SIFAG signent une convention pour la production de logements abordables et durables en Guyane
Le représentant d'ARMOS a souligné le caractère absurde de la situation : «nous avons d'un côté des milliers d'hectares libres mais inaccessibles ou protégés, et de l'autre une pénurie criante de terrains constructibles dans les zones urbaines et littorales où vivent 90% de la population.»
Cette situation paradoxale découle directement de la concentration de la propriété foncière. Comme l'a rappelé Malik Ho A Sim, plus de 90% du foncier est une forêt tropicale qui appartient essentiellement à l'État, et la partie réellement constructible est infime à l'échelle du territoire.
Lire aussi : Logement social : des besoins encore très élevés dans les Outre-mer, d’après l’Union sociale pour l’habitat
Des coûts d'aménagement prohibitifs
Au-delà de la disponibilité du foncier, se pose la question des coûts d'aménagement. Le représentant des aménageurs a expliqué que réaliser l'aménagement en Guyane «revient à créer la ville, à créer des quartiers neufs sur des terrains vierges où il faut tout construire : routes, réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement.» Résultat : le coût d'aménagement urbain s'élève à 100 euros le mètre carré, soit près d'un million d'euros par hectare avant même de pouvoir commencer à construire les logements.
Face à ce retard infrastructurel considérable, les opérateurs doivent régulièrement suppléer les collectivités dans la construction de la ville pour éviter d'aggraver les retards.
Un cadre réglementaire inadapté
La complexité administrative aggrave encore la situation. Le représentant d'ARMOS a révélé que près de 60% des constructions se font sans autorisation en Guyane, non pas par refus des règles, mais parce que les procédures sont trop longues et trop complexes dans un contexte d'urgence sociale. Des avancées législatives récentes ont été proposées, notamment la création d'un permis d'urbanisme unique pour simplifier les démarches, mais leur mise en œuvre reste insuffisante face à l'ampleur du défi.
Les peuples autochtones : une dépossession historique non résolue
Clarisse Da Silva, experte des questions autochtones, a rappelé l'existence en Guyane de six nations autochtones : les Kali'nas, les Tekos, les Wayampis, les Lokono-Arawakas, les Palikurs et les Wayanas, présents du fleuve Maroni jusqu'au fleuve Oyapock. Elle a insisté sur un point essentiel : la question foncière en Guyane n'est pas une question communautaire, c'est une question structurelle, transversale, qui concerne l'ensemble du territoire, des collectivités, des secteurs économiques, des habitants du littoral comme de l'intérieur.
La concentration de la propriété foncière dans les mains de l'État crée une dépendance structurelle particulièrement problématique pour les peuples autochtones. Comme l'a expliqué Clarisse Da Silva, près de 90% du territoire est propriété de l'État, ce qui signifie que presque toutes les décisions stratégiques — affectation, concession, autorisation — dépendent d'administrations situées soit à Cayenne, soit à Paris directement. Cette centralisation entraîne plusieurs conséquences désastreuses : une dépendance structurelle pour valider des projets, des délais d'instruction beaucoup trop longs pour les communes et les populations, une superposition d'affectations forestières créant des conflits d'usage, et l'absence d'outils permettant une véritable organisation du foncier à l'échelle locale.
Des dispositifs juridiques inadaptés
Les outils juridiques existants ne répondent pas aux besoins des communautés autochtones. Clarisse Da Silva a détaillé leurs insuffisances : les Zones de Droit d'Usage Collectif (SDUC) sont souvent trop petites, ne confèrent aucun type de propriété et ne permettent pas de réaliser des projets d'habitat ou d'activité économique. Les concessions d'État sont gérées par des procédures lourdes et longues, sans garantie de reconduction. Quant aux cessions, elles donnent certes accès à la propriété, mais entraînent immédiatement une fiscalité foncière que beaucoup de familles ne peuvent assumer. Le constat est implacable : pas de propriété, pas de gestion, pas de développement et pas de souveraineté. «Ce système empêche les peuples autochtones d'être acteurs économiques et de participer pleinement au développement du territoire», décrit Clarisse Da Silva
Une revendication légitime ignorée
Face à cette situation, depuis 8 ans, les peuples autochtones demandent la restitution d'environ 400 000 hectares, soit moins de 5% du territoire, une demande inscrite dans les accords de Guyane de 2017. Cette revendication poursuit plusieurs objectifs essentiels : sécuriser les zones d'habitat, de subsistance et de pratiques culturelles, garantir la continuité territoriale, réduire les conflits d'usage, permettre une planification locale des projets, et garantir la souveraineté territoriale.
Le député Jean-Victor Castor a illustré l'absurdité de la situation actuelle en citant l'exemple de Camopi : « la commune de Camopi n'avait quasiment pas de foncier jusqu'à récemment, même pas 100 hectares. Pour construire une simple crèche, le maire autochtone doit demander l'autorisation au préfet.»
Au-delà de la question foncière stricto sensu, Clarisse Da Silva a souligné l'importance de reconnaître le droit coutumier, aujourd'hui complètement invisibilisé dans le droit français. Elle a donné des exemples concrets de cette inadéquation : des espèces essentielles à l'alimentation et aux pratiques culturelles comme les plumes d'oiseaux rares, la chasse de gibiers particuliers, ou la consommation d'œufs de tortue à certaines périodes sont désormais interdites de prélèvement à cause de pratiques abusives commises par des acteurs extérieurs. Or, les communautés autochtones et afro-descendantes ont toujours réussi à gérer durablement ces ressources et se trouvent pénalisées par ces législations.
Clarisse Da Silva a insisté : la non reconnaissance du droit coutumier est aujourd'hui un obstacle majeur à la protection des cultures, à la transmission des savoirs et à l'exercice collectif des droits autochtones.
Des crises environnementales et sanitaires aggravées par l'abandon
La pollution au mercure et absence d'accès à l'eau potable
La question foncière se double d'une crise sanitaire majeure liée à l'orpaillage. La députée Mathilde Panot a rappelé que le peuple guyanais est gravement exposé aux métaux lourds, mercure et plomb, au travers de la bio-accumulation le long de la chaîne alimentaire. Les chiffres sont alarmants : l'incidence du saturnisme est 60 fois plus élevée en Guyane qu'en Hexagone, et à Pidima, près de 70% des adultes et 60% des enfants présentent une contamination dépassant le seuil critique défini par l'OMS.
Clarisse Da Silva a révélé une situation préoccupante : les villages wayanas et tous les villages aux alentours des communes n'ont pas accès à l'eau potable. Lors d'un déplacement à Maripasoula en septembre, il a été constaté que depuis plusieurs années, l'accès à l'eau potable n'est absolument pas garanti, avec des habitants vivant dans des conditions horribles, ne pouvant ni se baigner ni consommer l'eau des fleuves. Même avec des filtres, la quantité d'eau disponible est minime pour des villages comptant parfois plus de mille habitants. «Cette situation relève presque de l'urgence humanitaire sur le territoire français», précise l'experte des questions autochtones.
Lire aussi : Les peuples autochtones de Guyane réclament la reconnaissance de leurs droits
L'érosion côtière et les futurs réfugiés climatiques
Le village d'Awala-Yalimapo fait face à une érosion côtière dramatique. Clarisse Da Silva a expliqué que la barrière anti-submersion mise en place par la mairie, appelée Watergate, a montré son incapacité à protéger les habitants lors des très grandes montées des eaux de ces deux derniers mois. Un habitant a déjà dû être délogé l'année dernière, posant la question des futurs réfugiés climatiques. Pourtant, ni la collectivité ni la municipalité n'ont proposé de plan d'évacuation ou d'urbanisation nouvelle, faute de maîtrise foncière.
Un changement de paradigme indispensable
Le député Jean-Victor Castor a été catégorique : la problématique est politique, elle est coloniale. «Il a fallu près de 40 000 personnes bloquant la base spatiale et son occupation par des milliers de personnes pour qu'un accord soit inscrit au journal officiel : les accords de Guyane.» Cette situation révèle l'ampleur de la mobilisation nécessaire pour obtenir des avancées pourtant légitimes. Comme l'a souligné le député, «nous sommes en 2025, il faut se rendre compte de la situation : c'est un problème colonial, c'est un problème politique qu'il faut régler politiquement.»
Lire aussi : Le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco simplifie la rétrocession du foncier aux communes de Guyane
Le député Castor a également insisté sur un point crucial : «à partir du moment où vous n'occupez pas le territoire, il est occupé par d'autres, donc vaut mieux une activité légale et régulée, vaut mieux faire des logements plutôt que de laisser les squats se propager partout.» Sa conclusion est sans appel : la Guyane a vraiment besoin d'un plan pluriannuel d'investissement pour aménager le territoire, car «tant qu'on n'aménagera pas, il sera occupé et pillé, spolié par d'autres.»
Vers une gouvernance territorialisée et l'urgence d'agir
Clarisse Da Silva a appelé à un changement de modèle radical : il faudrait que l'État apporte son expertise juridique et législative, mais surtout qu'il laisse la Guyane piloter également son foncier.
Que ce soit pour l'agriculture, le logement ou les droits des peuples autochtones, la concentration de 90 à 95% des terres entre les mains de l'État crée des blocages structurels qui empêchent tout développement harmonieux.
Les intervenants ont adressé aux parlementaires un appel clair : simplifier radicalement les procédures de cession des terres, engager l'État dans le financement des infrastructures nécessaires, sanctuariser les financements du logement social, restituer les 400 000 hectares demandés par les peuples autochtones, reconnaître le droit coutumier et ratifier la Convention 169 de l'OIT.
Face à une population jeune en forte croissance, à des besoins de logements colossaux, à une agriculture vitale mais entravée, et à des peuples autochtones dépossédés de leurs terres ancestrales, l'inaction n'est plus une option pour les intervenants. «Il faut désormais lever les freins et agir vite» avant que la situation ne devienne encore plus critique.