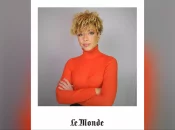Outremers360 poursuit sa série sur les personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire des Outre-mer. Décédée il y a 45 ans, la Guadeloupéenne Gerty Archimède devint la première avocate noire de France. Sa vie a été marquée par un engagement politique, social et féministe sans faille dont la constance continue à imposer le respect, en France et à l’étranger.
« Maître Archimède était une grande femme à la peau sombre, aux yeux vifs et au courage indomptable. Je n’oublierai jamais notre première rencontre. J’ai senti que j’étais en présence d’une très grande dame. Pas un instant je ne doutais qu’elle allait nous sortir de notre mauvaise posture. Mais j’étais tellement impressionnée par sa personnalité, le respect qu’elle attirait à elle en tant que communiste, même de la part des colonialistes que, pendant un certain temps, notre problème (avec les autorités françaises lors d’une escale en Guadeloupe, au retour de Cuba en 1969, résolu par l’intervention de Gerty Archimède, ndlr) me parut secondaire. Si je n’avais écouté que mes désirs, je serais restée sur l’île pour tout apprendre de cette femme », relate la célèbre militante afro-américaine Angela Davis dans son autobiographie.
Rien ne pourrait mieux résumer le charisme et la détermination de Gerty Archimède. Née le 26 avril 1909 à Morne-à-l’Eau en Guadeloupe, elle est la fille de Marie-Adélaïde Tamarin, une « téléphoniste » comme l’on disait à l’époque, et Justin Archimède, qui fut d’abord boulanger puis conseiller général de 1910 à 1945 et maire de Morne-à-l'Eau de 1912 à 1947. Après des études primaires et secondaires dans son île, elle va suivre des cours de droit à la Martinique avant de terminer sa licence à la Sorbonne à Paris. Elle passe le barreau de Guadeloupe avec succès et s’installe à Pointe-à-Pitre en 1939, devenant la première femme noire avocate de France.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, Gerty Archimède entre au Parti communiste français (PCF) et dirige la branche guadeloupéenne. Sa carrière politique décolle après le conflit. En avril 1944, le droit de vote et d’éligibilité est enfin accordé aux femmes. La même année, elle est élue conseillère générale, puis conseillère municipale de Basse-Terre de 1947 à 1952, et devient adjointe au maire de 1952 à 1955, le remplaçant même durant un an en 1956. Le 10 novembre 1946, elle est élue députée à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti communiste. Elle est membre de la Commission de la justice et de la législation et de la Commission des territoires d'Outre-mer, et nommée juge-suppléant à la Haute cour de justice. La même année, la loi du 19 mars fait de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion des départements français, qui sortent ainsi de leur statut de colonies.

Une aubaine pour Gerty Archimède qui va consolider ses engagements. En 1947, elle présente le rapport de la Commission de la justice et de la législation concernant le projet de loi visant à permettre aux femmes d'accéder à diverses professions juridiques. Par ailleurs, elle soumet plusieurs propositions de résolution, notamment sur le taux du franc dans les Antilles et en Guyane, ainsi que sur les mesures de reconstruction des quartiers incendiés de Pointe-à-Pitre en 1948 et 1951. La députée dépose également des propositions de loi portant sur l'amnistie des délits politiques en Outre-mer et l'harmonisation des salaires entre les départements ultramarins et l’Hexagone. Cependant, de manière plus étonnante pour cette personnalité militante, elle s'abstient lors du débat sur le statut de l'Algérie en août 1947.
En 1948, Gerty Archimède crée en Guadeloupe une section de l’Union des femmes françaises, proche du PCF, qui deviendra plus tard l’Union des femmes guadeloupéennes. Cette dernière se bat pour obtenir les droits à la sécurité sociale et à la retraite pour toutes les femmes de l’île. Les élections législatives de juin 1951 (puis de janvier 1956) constituent par contre un revers pour l’avocate, qui n’est pas réélue. Qu’à cela ne tienne, la voilà de retour dans les tribunaux. En août 1951, à Bordeaux, elle participe à la défense des accusés de l’affaire des « 16 de Basse-Pointe », impliquant des coupeurs de cannes martiniquais arrêtés après le meurtre d’un administrateur blanc, survenu dans un contexte de tensions sociales et raciales. Tous les accusés sont finalement acquittés. Par la suite, Gerty Archimède s’impose comme une figure emblématique du barreau guadeloupéen, qu’elle préside comme bâtonnière de 1967 à 1970.
En 1969, elle assure avec succès la défense d’Angela Davis et de sa délégation, de passage en Guadeloupe de retour de Cuba, dont les passeports avaient été confisqués par les douanes françaises. L’égérie afro-américaine évoquera cet épisode dans un livre (voir en début d’article). Gerty Archimède continua tant qu’elle le put son engagement féministe et social, au niveau local et international, animant des conférences à l’étranger. Elle s’éteint le 15 août 1980 à Basse-Terre en Guadeloupe. De nombreuses rues, places et édifices portent son nom, dans son pays natal et dans l’Hexagone. Son ancienne maison à Basse-Terre est devenue un musée en 1984, labellisé « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture en 2012. En 2013, elle fait partie d’une liste de femmes proposées au président François Hollande pour entrer au Panthéon. Par ailleurs, la Région Guadeloupe déclara 2019 comme « l’année Gerty Archimède ».
PM
► À lire aussi
Grandes figures des Outre-mer : Cyrille Bissette, l’abolitionniste méconnu de la Martinique