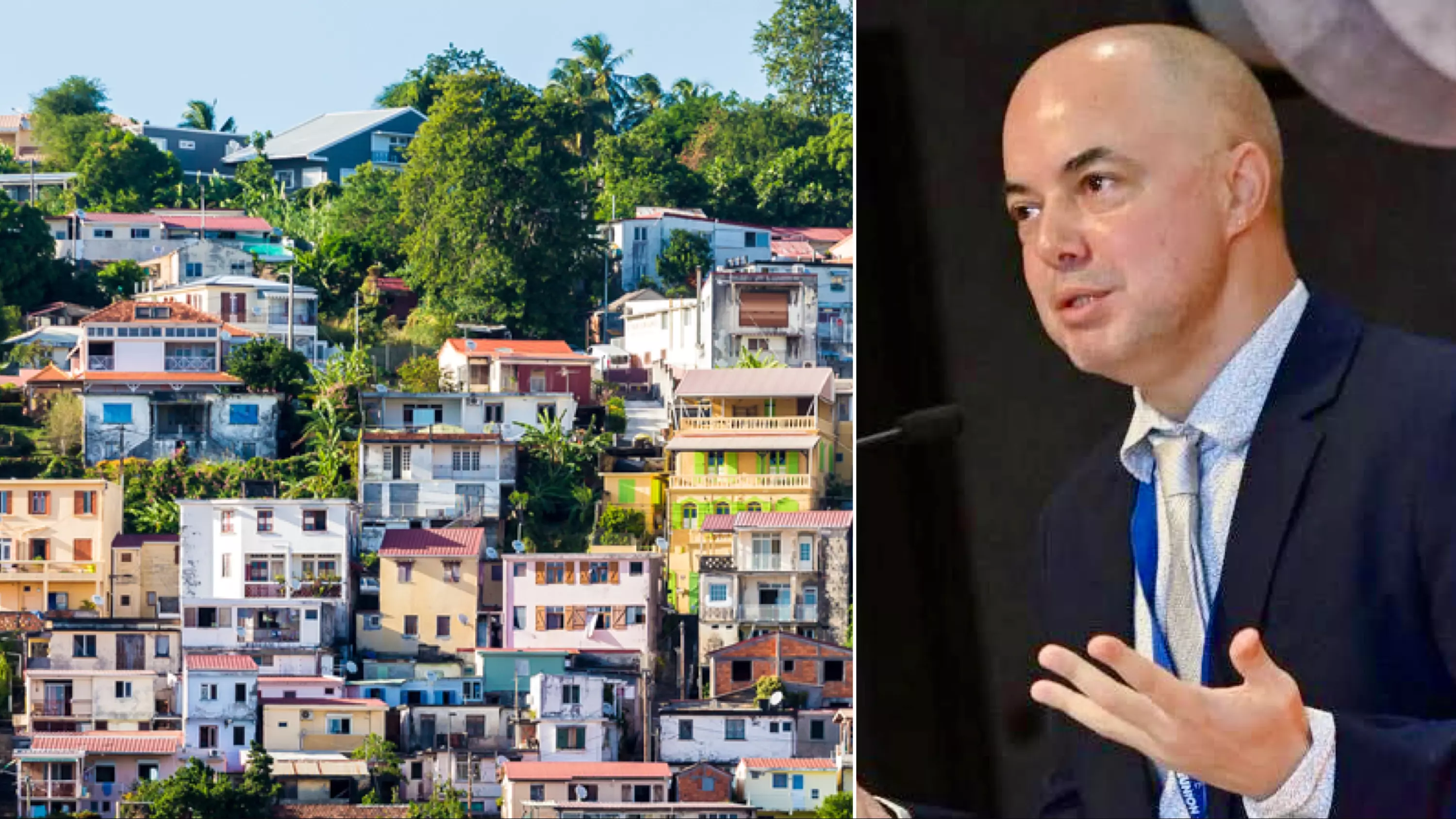S’il est une régularité qui caractérise la situation des Départements et Régions d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), c’est bien celle des inégalités socio-économiques, un phénomène historiquement construit comme le montre Jean-François Hoarau dans un article publié dans la Revue Économique, et dans une tribune pour la rédaction d’Outremers360.
L’égalité civile (accès au suffrage universel pour les hommes) est une réalité dès 1848. L’égalité politique est obtenue en 1946 (en 2011 pour Mayotte) avec la départementalisation. L’égalité des droits sociaux n’est acquise qu’à la fin des années 2000 (avec un report en 2025 pour Mayotte). Toutefois, les sept décennies de décolonisation qui viennent de s’écouler n’ont fait que déplacer le problème en transformant les inégalités civiles et sociales en inégalités réelles. En conséquence, un consensus est désormais largement établi : les inégalités traditionnelles de répartition de revenus et de patrimoine, dites « primaires », s’accompagnent d’inégalités « secondaires » en matière d’accès à la sécurité, à l’emploi, à l’alimentation, à la santé, au logement, à l’énergie, à l’éducation, au transport et aux services publics en général pour les populations les plus pauvres, les plus éloignées ou isolées de ces territoires. Ces inégalités sont à l'origine (au moins en partie) de nombreux dysfonctionnements tels que la vie chère, la pauvreté, l’insécurité, la sur exposition aux phénomènes extrêmes, ...
En corollaire, un autre constat s’impose. Les politiques « républicaines » économiques, sociales, éducatives et migratoires implémentées dans les DROM depuis la fin de la colonisation n’ont pas permis de briser cette structure sociale très inégalitaire, se traduisant par une marginalisation croissante des populations précaires. Trois phases plus ou moins longues dans l’application de ces politiques publiques peuvent être distinguées. La première phase, qui débute à partir de 1946, se focalise sur la fourniture des infrastructures de base afin d’améliorer les structures matérielles du bien être humain et particulièrement les conditions sanitaires. La seconde phase, lancée dans les années 1960-1970, s’attaque aux volets démographiques, éducatifs et sociaux avec pour objectif d’éradiquer la pauvreté endémique. La troisième phase, plus productive en termes de réduction visible de la pauvreté et des inégalités, enclenchée dans les années 1980-1990, aborde les aspects économiques et institutionnels pour construire les bases d’un développement endogène et différencié selon les territoires. La prochaine phase, en cours de lancement, amorcée par la loi sur l’égalité réelle, votée le 28 février 2017, en proposant pour le monde ultramarin, à l’horizon 2030-2040, un alignement total du droit et des dépenses publiques sur le niveau national, constitue un effort notable dans la bonne direction. Néanmoins, elle reste ancrée dans la logique du Welfare colonialism, laissant de côté les racines du « Mal » des inégalités, en l’occurrence l’histoire et les effets toujours actifs de ses institutions coloniales. Et pourtant, plusieurs directions pourraient être empruntées dans ce domaine.
En premier lieu, si comme l’indique l’approche de la démocratie capturée des récents prix Nobel d’économie Daron Acemoglu et James Robinson, une pratique politique démocratique peut créer les conditions favorisant les intérêts des élites, alors il faut non seulement réduire la capacité de ces derniers à contrôler les décideurs politiques, en sacralisant l’éthique politique, mais aussi limiter l’intérêt pour les élites d’investir dans la construction d’un pouvoir de facto. En particulier, il convient de combattre les comportements de rente associées aux situations de monopole et d’oligopole qui caractérisent trop souvent les marchés ultramarins (notamment les pratiques de marges abusives et/ou de multiplication des intermédiaires aux origines de « la vie chère »).
En second lieu, il s’agirait de revoir la répartition des dotations initiales, que d’aucuns qualifieraient d’injuste (passé colonial, sur rémunération des fonctionnaires, effets de captation de rente par certains acteurs économiques), en repensant les droits de propriété privé sur le capital économique. Si la proposition de Christiane Taubira en 2013, alors ministre de la Justice, de « rendre leurs terres aux descendants d’esclave », paraît difficile à mettre en place, une solution plus douce pourrait néanmoins être envisagée en suivant les principes de l’approche novatrice du « socialisme démocratique, autogestionnaire et décentralisé » de Thomas Piketty. L’idée de créer un système de redistribution de l’héritage permettant à l’ensemble des populations de recevoir un héritage minimal qui serait financé par un mélange d’impôt progressif sur la fortune et sur les successions est particulièrement séduisante. Celle d’un système de garantie d’emploi (à temps plein au salaire minimum en vigueur), financé en partie par une plus grande progressivité de l’impôt sur les revenus, pour toutes les personnes qui le souhaitent, l’est tout autant. Pour les DROM, cela implique de revendiquer et d’obtenir l’autonomie fiscale, laquelle est pour le moment loin d’être acquise, en tout cas sans une révision constitutionnelle majeure.
En troisième lieu, déconstruire l’habitus colonial au sens de Nicolas Roinsard et le fatalisme de la pauvreté et des inégalités comme norme sociale pour les populations historiquement dominées doit être une priorité absolue. Il convient ici d’insister sur le rôle primordial de l’éducation. Plus précisément, il s’agit de repenser une école de la République moins obsédée par l’excellence académique et mieux adaptée à des populations situés dans des géographies particulières et marquées par une grande diversité socialement et anthropologiquement constituée.
En dernier lieu, l’évolution institutionnelle en matière de diplomatie territoriale mérite d’être poursuivie, au-delà de la logique trop restrictive des dérogations, pour que les économies ultramarines deviennent des centres intégrés dans leur espace régional. Cet aspect est particulièrement déterminant dans le domaine de la politique commerciale. Il permettrait d’optimiser la politique d’import-substitution en réduisant la distance et le coût des matières premières et des consommations intermédiaires nécessaires au système productif local (en incitant à développer les réseaux régionaux d’approvisionnement et en offrant la possibilité d’adaptation des normes), d’une part, et d’ouvrir la voie à une vraie politique d’exportation adaptée vers les marchés régionaux, d’autre part. Limiter la pression sur les prix intérieurs et distribuer davantage de revenus par la création d’emplois sont en effet des enjeux majeurs dans la lutte contre les inégalités.
Plus généralement, il s’agit pour les Outre-mer de muter de la stratégie « Migration, Remittances, Aids, and Bureaucracy » (MIRAB) à la stratégie « People, Resources, Overseas management, Finance and Transport » (PROFIT). Ce modèle dit « de dépendance autonome » s’articule autour de deux éléments fondamentaux : (i) la capacité à obtenir de la part de la « métropole » des avantages asymétriques en matière de taxation, d’aides publiques ou de subventions d’investissement (comme c’est déjà le cas) mais renforcée par une approche pro-active s’appuyant sur la valorisation des services non marchands stratégiques que ces territoires rendent à la Nation et (ii) l’attribution d’une marge de souveraineté pour pouvoir dessiner et décider de façon autonome une trajectoire adaptée d’un développement économique socialement soutenable. C’est la voie qui a été choisie par les collectivités d’Outre-mer (à des degrés divers) et les îles de nos partenaires européens (Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Portugal). D’ailleurs, les travaux de Nicolas Lucic, présentés dans une thèse soutenue récemment, révèlent sans ambiguïté que les petits territoires insulaires non indépendants, mais disposant d’un certain degré de souveraineté, affichaient globalement les niveaux de développement les plus élevés du monde insulaire.
La littérature récente montre clairement que les décisions contemporaines peuvent changer le cours de l’histoire à bien des égards. Mais pour cela, il faudrait une vraie volonté politique prête à regarder en face un passé certes douloureux, non pas pour désigner des coupables (qui sont morts depuis longtemps), non pas pour faire acte de repentance (légitime sur le plan symbolique mais peu utile pour améliorer le sort des populations concernées), mais pour identifier et démanteler les mécanismes institutionnels, hérités des temps coloniaux, qui sont encore à l’œuvre aujourd’hui. Malheureusement, l’immobilisme ambiant en la matière, dans une France indubitablement complexée par son histoire coloniale, nous amène à nous demander si les causes de la persistance de la pauvreté et des inégalités dans les Outre-Mer sont véritablement historiques ou plutôt la conséquence d’une volonté présente et durable de maintenir certains privilèges et les situations de rente.
Jean-François Hoarau, Professeur des universités, CEMOI, Université de La Réunion